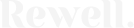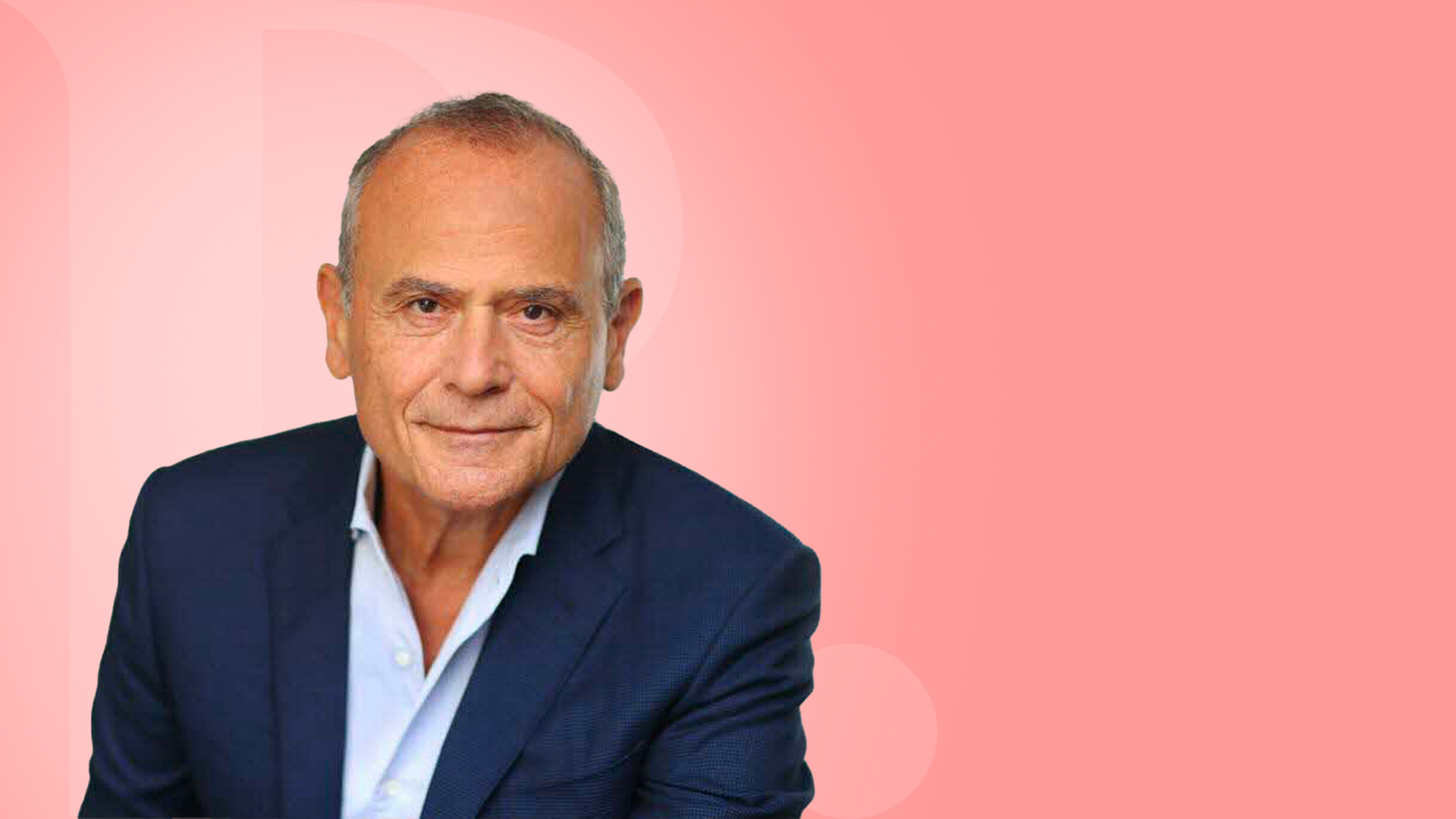Fatigue inexpliquée, règles douloureuses, sautes d'humeur, troubles du sommeil, prise de poids… Et si tout cela venait d'un simple déséquilibre hormonal ? Trop souvent minimisés, ces signes touchent pourtant près de 80 % des femmes au cours de leur vie. Bonne nouvelle : il existe des solutions naturelles et efficaces pour reprendre le contrôle de …